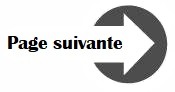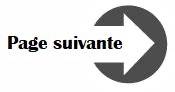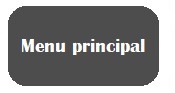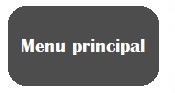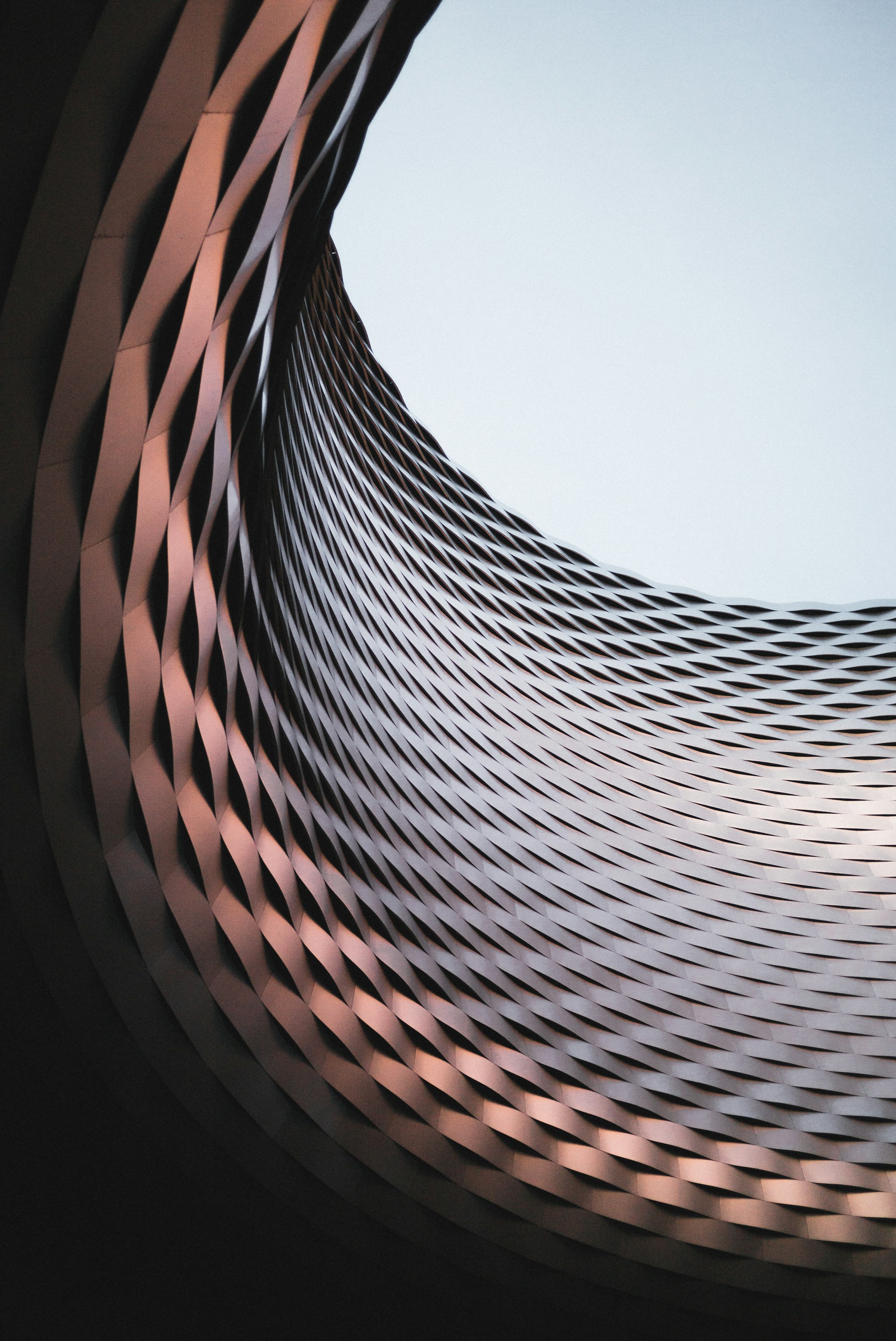
Essais à Kapustin Yar
[1] Asif A. Siddiqi, Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974, University Press of Florida, 2000, page 71
[2] Le cosmodrome de Plesetsk est une base de lancement russe situé à 200 km au sud d'Arkhangelsk et à 800 km au nord de Moscou qui constitue le principal centre de lancement des satellites militaires du pays. Le centre a été créé en 1957 en tant que base de lancement des missiles balistiques intercontinentaux R-7 Semiorka avant d'accueillir à compter de 1966 des activités spatiales militaires. Des lancements de satellites civils, parfois étrangers y ont désormais lieu mais le centre comporte toujours des missiles balistiques opérationnels en silo. Le cosmodrome dispose de pas de tir dédié aux lancements des fusées Molniya/Soyouz, Cosmos, Tsyklon, Rokot. L'existence de la base a été maintenue secrète jusqu'en 1983 malgré un rythme de lancement très élevé (1 500 tirs entre 1966 et 1997) qui s'est fortement ralenti depuis l'éclatement de l'Union soviétique.


Sergey N. Vernov, directeur adjoint de l'Institut de recherche scientifique pour la physique nucléaire
En 1948, le nouveau programme de missiles balistiques soviétiques était quasiment exclusivement d’ordre militaire. Pourtant, des échanges plus scientifiques sur l’intérêt des fusées à hautes altitudes et sur la stratosphère commençaient à émerger. Les travaux de la Commission d'étude de la stratosphère avaient été relancés après-guerre grâce aux efforts du physicien nucléaire Sergey N. Vernov, directeur adjoint de l'Institut de recherche scientifique pour la physique nucléaire. Korolev a rencontré le président de l'Académie des sciences de l'URSS Sergey I. Vavilov en 1949 pour coordonner la conception et le développement d'instruments pour le vol de missiles dérivés de l'A-4. A l’issue de cette rencontre, Vavilov a confié le sujet à l'académicien Keldysh, qui, à son tour, a utilisé la Commission Stratosphère existante pour établir, à la fin de 1949, la nouvelle Commission d'enquête sur la haute atmosphère. L’académicien Blagonravov, président de l'Académie des sciences de l'artillerie de l'URSS, a été nommé directeur de cette commission avec pour mission de coordonner la branche scientifique du programme soviétique de missiles balistiques. Korolev et son département au sein du NII-88 avaient déjà commencé à ce moment les premiers essais de la nouvelle version du missile R-1, désigné le R-1 A. Pour Korolev, les travaux de création du R-1 A étaient une étape transitoire vers le R-2. En 1949, une série de fusées expérimentales R-1 A était spécialement destinée à tester la séparation de la charge utile en vol. Le premier de ces missiles de test a été lancé sur une trajectoire balistique de Kapustin Yar le 7 mai 1949, équipé pour la première fois d'un conteneur en forme de cône non récupérable. Au total six essais du R-1 A ont été menés en mai sous la direction de Korolev, pour tester la séparation des ogives.
Le premier R-1 A avec des containeurs d’études scientifiques opérationnels, a été lancé à 4 h 40, heure locale, le 24 mai 1949. Les instruments conçus pour mesurer la pression et la composition de l'air avaient été développés à l'Institut géophysique de l'Académie des sciences sous la direction de Vernov lui-même. Juste avant le lancement, des conteneurs en verre spéciaux ont
été vidés de leur air et hermétiquement scellés et installés dans les coffres de la charge utile. A l'exception de la conception du module séparable, le R-1 A n’était pas très différent du R-1 militaire. Le véhicule mesurait un peu moins de quinze mètres de long et avait une masse en carburant de 13 910 kilogrammes. Le lancement a été couronné de succès et les containeurs se sont éjecté sans problème à une altitude d’environ 100 kilomètres. Dix-sept secondes après l'éjection, ils ont commencé leur chute de vingt kilomètres en vol libre. Le parachute de freinage s’est déployé, mais le choc de son déploiement a endommagé la voilure. L'atterrissage a été beaucoup plus difficile que prévu. Les deux conteneurs ont été abimés en touchant le sol, les données scientifiques n’ont pas été récupérées. Pourtant les instruments avaient fonctionné comme prévu. Dans les jours qui ont suivi, les ingénieurs ont modifié rapidement le système de parachute, tout en améliorant aussi les capacités d'absorption des chocs des conteneurs. Un deuxième lancement a eu lieu le 28 mai. Cette fois, le missile a atteint une altitude de 102 kilomètres et les deux conteneurs ont été récupérés sans incident. Malheureusement pour les scientifiques, l'équipement de mesure avait mal fonctionné, affectant la qualité des informations recueillies. De toute évidence, les résultats scientifiques des deux lancements ont été maigres, mais le résultat global de la série a été jugé satisfaisant. Korolev a ainsi résumé les lancements :
Nous avons pu montrer expérimentalement qu'il était possible de transporter du matériel pour l'étude des couches supérieures de l'atmosphère par fusée à des altitudes de 100 kilomètres, d'éjecter le conteneur rempli d'équipement et d’effectuer en toute sécurité un retour sur terre. Pour la première fois, il a été possible de faire des mesures directes de la pression atmosphérique à une altitude d'environ 100 kilomètres et de prélever des échantillons d'air. Malgré les modestes résultats de ces premiers lancements et de nombreuses déficiences techniques et méthodologiques, ainsi que de graves défauts d'équipement, ces prouesses ont réveillé l'enthousiasme de tous les êtres humains et ont éveillé l'intérêt des instituts et des organisations de l'Académie des sciences de l'URSS ainsi que de l'industrie.[1]


Mikhail G. Grigoriev, colonel de la 1ère brigade de la future force de missiles stratégiques de l'URSS
Pendant cette période, de nombreux tirs ont été effectué à Kapustin Yar. Les tirs les plus nombreux étaient ceux du R-1, la deuxième série de test étant conçu pour remédier aux mauvaises performances de fin 1948. Les lancements ont été effectués entre septembre et octobre 1949, toujours sous la direction de Korolev. Contrairement à la première série qui avait fait douter le commandement militaire, la deuxième série a restauré la confiance. Sur un total de vingt missiles lancés, dix-sept ont atteint leur zone cible, il n’y a eu que deux échecs. Il a fallu attendre encore près d’un an pour qu'une commande définitive soit émise le 28 novembre 1950, adoptant officiellement le missile R-1 comme armement des forces armées soviétiques. Le missile R-1 est entré en production seulement à partir de 1951. L’Union soviétique avait un retard industriel de 15 ans expliquant la mise en production tardive. En service sur le terrain, la fusée nécessitait vingt véhicules et quatre types de propergols liquides pour le moteur principal, les turbines et le démarreur (oxygène liquide, alcool, peroxyde d'hydrogène, catalyseur au permanganate). Six heures étaient nécessaires pour préparer la fusée au lancement. Les généraux de l’Armée Rouge ont souvent objecté qu’ils n'osaient pas laisser leurs troupes travailler avec une fusée utilisant de l'alcool comme propulseur... La première unité de campagne R-1 formée a été la 23e brigade du génie spécial. La brigade, dirigée par le colonel Mikhail G. Grigoriev, allait être à l'origine de ce qui deviendra plus tard la fameuse force de missiles stratégiques de l'URSS. Comme beaucoup d'autres officiers d'artillerie de l'époque, Grigoriev jouera un rôle de premier plan dans le programme spatial soviétique en tant que premier commandant en chef du site de lancement de Plesetsk, cosmodrome russe[2]. La fusée R-1 a été décliné dans plusieurs versions utilisées pour des tests technologiques et scientifiques.